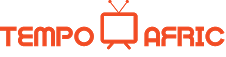Afrobasket féminin 2017: le Mali rejoint le Sénégal en quarts

L’équipe du Mali, hôtesse du Championnat d’Afrique des nations féminin de basket-ball (Afrobasket 2017), s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Afrobasket 2017, le 22 août à Bamako. Dans le groupe A, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la Tunisie vont se disputer les deux dernières places pour le prochain tour, ce 23 août. On connaît désormais six des huit équipes qui disputeront les quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations féminin de basket-ball (Afrobasket 2017), organisé au Mali du 18 au 27 août.
Dans le groupe B, tout est déjà réglé ou presque. Le Mozambique et l’Egypte se sont qualifiés le 22 août à Bamako, après le Nigeria et le Sénégal la veille. Les Mozambicaines ont remporté une victoire décisive face aux Congolaises de RDC 52-42, tandis que les Egyptiennes s’en sont sorties malgré une déroute face aux Sénégalaises 61-93. Les Mozambicaines et les Egyptiennes, respectivement 3e et 4e du groupe B, ne peuvent en effet plus être rattrapées au classement par des Congolaises et des Guinéennes qui ont perdu tous leurs matches depuis le début de l’Afrobasket 2017.
Les Maliennes seront au rendez-vous
C’est dans le groupe A qu’il reste du suspense, ce 23 août. Les Camerounaises, les Ivoiriennes et les Tunisiennes vont ainsi se disputer les deux dernières places en quarts de finale de l’Afrobasket 2017. Le Cameroun, qui affronte le Mali ce mercredi à 18h30 TU, est en ballotage favorable après son succès 64-49 face à la Tunisie. Troisièmes au classement derrière l’Angola et le Mali, les « Lionnes indomptables » connaitront peut-être leur sort après la rencontre Tunisie-Côte d’Ivoire, prévue à 16h15 TU. Vont-elles affronter des Maliennes peu motivées car déjà qualifiées ? Pas sûr. Le Mali conserve un mince espoir de finir premier du groupe A, si jamais les Centrafricaines surprennent les Angolaises, ce mercredi.
Read more »Grace Mugabe quitte l’Afrique du Sud protégée par «une immunité diplomatique»
Par RFI Publié le 20-08-2017 Modifié le 20-08-2017 à 17:02
La première dame zimbabwéenne, Grace Mugabe, a quitté l’Afrique du Sud, ce dimanche 20 août, sans encombre. C’est le groupe audiovisuel public zimbabwéen, ZBC, qui a annoncé, ce dimanche matin, le retour au Zimbabwe de l'épouse du président Mugabe. Grace Mugabe qui accompagnait, à Johannesburg, son mari au sommet de la SADC, est visée par une plainte d'une mannequin sud-africaine, d'une vingtaine d'années. Elle l'accuse de l'avoir frappée à coups de rallonge électrique alors qu'elle rendait visite à un de ses enfants dans un hôtel de Johannesburg. Grace Mugabe a bénéficié d'une immunité dipomatique que lui ont accordée les autorités sud-africaines.
Le couple présidentiel zimbabwéen a atterri tôt, ce dimanche, à Harare, coupant court au sommet de la SADC qui s’achève, aujourd’hui, à Pretoria. Grace Mugabe a donc pu rentrer sans encombre malgré la plainte déposée contre elle en Afrique du Sud et les menaces de la police qui avait lancé une « alerte rouge » aux postes-frontière pour l’empêcher de quitter le territoire. Une notice publiée samedi dans la Gazette Officielle et signée par la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, confirme que la première dame zimbabwéenne a finalement obtenu l’immunité diplomatique qu’elle réclamait. On ignore également le détail de ce qui s’est joué, en coulisse, ces dernier jours. Un indice peut-être: vendredi soir, un avion de la compagnie Air Zimbabwe a été retenu au sol à l’aéroport OR Tambo de Johannesburg et samedi, c’est un appareil de la compagnie South African Airways qui a été empêché de décoller depuis Harare, officiellement pour une simple question de permis de vols internationaux.
Cependant, cette crise aérienne soulève bien des soupçons d’autant plus que les vols ont repris, dans la matinée de ce dimanche, au moment même où la première dame fait son retour au pays. L’équipe juridique de la plaignante, Gabriella Engels, a déclaré, ce dimanche matin, qu’elle étudiait de nouveaux recours contre Grace Mugabe. De son côté, après le départ de Grace Mugabe, l'Alliance démocratique, principal parti de l'opposition sud-africaine, a demandé une enquête parlementaire immédiate sur le rôle du gouvernement dans ce qu'elle appelle « la fuite en pleine nuit de Grace Mugabe pour éviter une procédure criminelle ».
Inondations en Sierra Leone: plus de 400 morts et de nombreuses familles séparées
Par RFI Publié le 19-08-2017 Modifié le 19-08-2017 à 11:48
En Sierra Leone, le bilan des inondations, survenues le lundi 14 août, dépasse désormais les 400 morts. A cela s'ajoutent environ 600 personnes toujours portées disparues dans la capitale, Freetown. Le pays, aidé par des organisations internationales, s'organise pour venir en aide aux populations touchées qui ont parfois tout perdu. Cinq jours après le drame, l'un des défis, c'est de permettre de réunir des familles qui ont été séparées. Reportage RFI.
Reportage de notre envoyée spéciale,
Dans le centre d'accueil de Don Bosco Fambul, à Freetown, une quarantaine de femmes et d'enfants sont assis sur des matelas posés à même le sol. Un peu de répit après avoir vécu l'enfer. Certains portent des bandages. Ils ont été blessés lorsque, dans la nuit de dimanche à lundi, en raison de fortes pluies, des torrents de boue ont dévalé les rues et des pans de collines se sont effondrés sur leurs maisons. « C'est un des plus gros traumatismes pour les enfants. Certains sont orphelins ou bien leurs parents ne savent pas où ils sont et les cherchent. Donc, ce que nous allons faire c'est afficher, à l'entrée du Centre, les photos des enfants », explique le père Jorge Mario Crisafulli, le directeur du Centre.
Dans la panique et l'urgence, de nombreuses familles ont en effet été séparées. Certains habitants se sont réfugiés chez des voisins, d'autres dans des centres d'accueil mis en place à la hâte. Certains ont été hospitalisés et n'ont aucun moyen de prévenir leurs proches. Afin de les mettre en contact, des équipes de la Croix Rouge de Sierra Leone et du Comité international de la Croix Rouge font le tour des centres, quartiers et hôpitaux.
« On va voir toutes les personnes et on leur demande si elles sont en contact avec leur famille ou pas. Dans le cas où elles ne sont pas en contact avec leur famille, on leur demande si elles ont un numéro de téléphone pour les joindre », détaille Hanna Lahoud, chef d'équipe protection au CICR. En attendant, à l'extérieur, accolée à la bâtisse de Don Bosco, une vaste tente blanche a été dressée, prête à accueillir, dans les prochains jours, d'autres mineurs isolés. Après ces inondations, l'UNICEF explique que l'une des priorités est d'empêcher la diffusion de maladies comme le choléra ou encore la malaria. Depuis plusieurs jours, le fonds des Nations Unies pour l'enfance est à pied d'œuvre dans les quartiers les plus touchés où il distribue de l'eau potable et construit des latrines.
Référendum constitutionnel au Mali: IBK jette l'éponge, jusqu'à nouvel ordre
Par RFI Publié le 19-08-2017 Modifié le 19-08-2017 à 11:45
Dans une adresse solennelle aux Maliens dans la nuit de vendredi à samedi, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de surseoir au référendum sur le projet de de révision sur la nouvelle Constitution. Sur la question, deux camps, partisans et opposants de la révision constitutionnelle, se défiaient de plus en plus ouvertement.
Plus question, jusqu’à nouvel ordre, d’organiser un référendum sur le projet de nouvelle Constitution. Le président malien IBK, s’adressant aux Maliens très tard dans la nuit de vendredi à samedi à la télévision nationale, a déclaré : « J’ai décidé, en toute responsabilité, de surseoir à l’organisation d’un référendum sur la révision constitutionnelle. Pour le Mali, aucun sacrifice n’est de trop ! » Pour justifier sa décision, le président IBK évoque les tensions perceptibles sur le terrain ces derniers temps, au sujet du référendum. « J’ai enregistré avec inquiétude la montée des radicalités. Ces alarmes, nous les avons partagées, vous et moi. Je vous ai entendu exprimer vos craintes de voir notre cher pays dériver vers des affrontements tragiques ».
Incontestablement, le chef de l’Etat malien a tenu un discours d’apaisement. Il s’est même déclaré prêt à ouvrir un dialogue inclusif et dépassionné sur le sujet : nous devons nous écouter, a-t-il poursuivi. Peu avant son allocution, autre geste de décrispation, IBK a reçu au palais présidentiel une délégation de la plateforme « Touche pas à ma Constitution », plateforme très présente sur le terrain de la contestation.
 La Plateforme «Touche pas à ma constitution» était très présente dans les manifestations contre la réforme constitutionnelle, ici le 17 juin 2017. © Habibou KOUYATE / AFP
La Plateforme «Touche pas à ma constitution» était très présente dans les manifestations contre la réforme constitutionnelle, ici le 17 juin 2017. © Habibou KOUYATE / AFPFootball : le Kenya et le Cameroun accueilleront-ils le Chan 2018 et la CAN 2019 ? Réponse le 23 septembre

Respectivement organisateurs du Championnat d’Afrique des Nations (Chan) 2018 et de la CAN 2019, le Kenya et le Cameroun sauront le 23 septembre s’ils pourront accueillir les deux compétitions comme prévu.
C’est à Accra, le 23 septembre prochain, que la Confédération Africaine de Football (CAF) annoncera sa décision concernant le CHAN 2018 (11 janvier-2 février) et la CAN 2019 (juin-juillet 2019, dates à fixer). L’instance, qui sera réunie en Comité exécutif dans la capitale du Ghana, se basera sur les rapports qui lui auront été remis après les visites d’inspection effectuées par des experts indépendants mandatés par elle, assistés par ses propres techniciens.
Une mission aura lieu au Cameroun du 20 au 28 août, et c’est bien évidemment la question de la CAN 2019 qui tient en haleine le football africain, surtout depuis les récentes déclarations d’Ahmad Ahmad, le président de la CAF, lors d’un déplacement au Burkina Faso. Le Malgache y avait affirmé que le Cameroun accumulait les retards et qu’il n’était pas aujourd’hui en mesure d’organiser une CAN, « même à quatre équipes. »
Paul Biya, le chef de l’État camerounais, a beau avoir assuré que son pays tiendrait ses engagements, la cote du Cameroun n’est pas à son zénith. « Il y a des sites où les choses n’avancent pas assez vite, au niveau des structures sportives, mais aussi des hôpitaux, des transports, etc… On sait qu’en Afrique on a tendance à attendre le dernier moment pour agir, mais la CAF risque de se montrer intransigeante si le rapport explique qu’il y a trop de retard et que le Cameroun ne sera pas prêt », affirme un proche de la CAF.
La CAF risque de se montrer intransigeante si le rapport explique qu’il y a trop de retard et que le Cameroun ne sera pas prêt
Si le Cameroun était mis hors-jeu, un nouvel appel à candidatures serait lancé dès l’automne. L’Algérie et le Maroc ont fait savoir qu’ils étaient prêts à accueillir la compétition phare africaine, au cas où. « Il y a peu de pays qui pourraient remplacer le Cameroun. L’Afrique du Sud a tout ce qu’il faut, mais elle a été beaucoup sollicitée ces dernières années (Coupe du Monde 2010, CAN 2013 en remplacement de la Libye, CHAN 2014) et elle n’est pas
candidate », poursuit notre source.
Le Maroc, joker du Kenya ?
Quant au Kenya, cela fait déjà plusieurs mois que des rumeurs persistantes font état d’une probable délocalisation. Le pays d’Afrique de l’Est accumule lui aussi les retards, et la situation politique y est particulièrement tendue depuis la réélection d’Uhuru Kenyatta, contestée par l’opposition. Dans l’hypothèse où le Kenya serait disqualifié par la CAF, il est peu probable qu’un nouvel appel à candidatures soit lancé, pour cause de délais resserrés.
Et le Maroc, pressenti depuis les premières rumeurs sur une possible défection du Kenya, aurait alors de fortes chances d’être désigné, Ahmad Ahmad étant considéré comme un proche de Fouzi Lekjaa, le président de la fédération. Ce qui lui permettrait d’embellir son dossier de candidat à l’organisation de la Coupe du Monde 2026…
Auteur: Jeuneafrique - Webnews