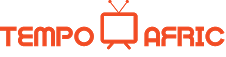Mali: libération du Sud-Africain Stephen McGown, enlevé par Aqmi en 2011
Stephen McGown, ressortissant sud-africain enlevé par le groupe al-Qaïda au Maghreb islamique en 2011, est libre. Il avait été kidnappé dans un restaurant de Tombouctou, dans le nord du Mali, en même temps qu'un Néerlandais, Sjaak Rijke, libéré en 2015, et qu'un Suédois, Johan Gustafsson, libéré cette année au mois de juin.
« Notre compatriote Stephen McGown a été libéré le 29 juillet 2017. Nous sommes heureux qu'il soit libre », a déclaré la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Maite Nkoana-Mashabane, lors d'un point presse à Pretoria qui lui a souhaité « un excellent retour chez lui », sans apporter de précisions sur les circonstances de sa libération.
« Pas de rançons », assure le gouvernement
Elle a également soigneusement évité de répondre aux questions portant sur le versement d’une éventuelle rançon. « Le gouvernement sud-africain ne paie pas de rançons », a-t-elle martelé. « C’est pourquoi je veux surtout insister sur le travail que nous avons mené ces six dernières années : parler avec le gouvernement malien, entrer en contact avec les preneurs d’otages comme nous savons le faire. C’est ce que nous pouvons confirmer aujourd’hui. »
De quoi susciter des spéculations, d’autant qu’un article du New York Times publié jeudi, affirme que de l’argent aurait été versé en échange de la libération de Stephen McGown, sans que l’information ne soit confirmée.
Emotion de la famille
Le père de Stephen McGown s’est également exprimé. Soulagé, Malcom McGown assure que son fils est en bonne santé : « Quand je l’ai serré dans mes bras, il était aussi fort qu’auparavant. Je peux donc dire qu’il a été bien traité là-bas. Le gouvernement a travaillé depuis le début. Cela a pris du temps, mais nous y sommes. Et je suis heureux de dire que mon fils va bien, qu’il est en bonne santé, et que son esprit est aussi aiguisé que d’habitude. »
 La ministre des Affaires étrangères, Maite Nkoana-Mashabane et Malcolm McGown, le père de l'ex-otage au Mali Steven McGown, lors d'une conférence de presse, à Pretoria, le 3 août 2017. © Phill Magakoe / AFP
La ministre des Affaires étrangères, Maite Nkoana-Mashabane et Malcolm McGown, le père de l'ex-otage au Mali Steven McGown, lors d'une conférence de presse, à Pretoria, le 3 août 2017. © Phill Magakoe / AFPLa femme de Stephen McGown, Catherine, a également pris la parole lors de ce point presse, pour raconter ses retrouvailles. « Il est arrivé, il m’a regardée et il m’a dit : "Oh ! Tes cheveux ont poussé !" Et je lui ai répondu : "En fait, tes cheveux sont encore plus longs que les miens maintenant ! », a-t-elle raconté, la voix chargée d’émotion. La mère Stephen McGown, elle, n'était pas présente. Son décès, un peu plus de deux mois avant la libération de l’otage sud-africain, avait marqué les esprits en Afrique du Sud.
Mais malgré la mobilisation des autorités, le sort de l’otage sud-africain n’a pas pour autant suscité une grande mobilisation de la part de l’opinion publique sud-africaine, très peu informée sur le sujet.
Enlevé le 25 novembre 2011
Stephen McGown avait été enlevé par des hommes armés en même temps que le Néerlandais Sjaak Rijk et le Suédois Johan Gustafssone, le 25 novembre 2011, alors que les trois hommes se trouvaient sur la terrasse de leur hôtel de Tombouctou. Lors du rapt, un Allemand avait résisté et avait été abattu. L'enlèvement avait par la suite été revendiqué par al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).
Le Néerlandais Sjaak Rijke avait été libéré le premier, en 2015, par les forces spéciales françaises. Le Suédois Johan Gustafsson avait pour sa part recouvré la liberté au mois de juin dernier, après plus de cinq ans de captivité. Il avait alors affirmé avoir été détenu avec Stephen McGown et indiqué que ce dernier était globalement en bonne santé.
Une vidéo du groupe de Iyad Ag Ghali
Le 31 juin, à la veille du sommet du G5 Sahel, le Sud-Africain qui vient de recouvrer la liberté faisait partie des six otages présentés dans une vidéo de la coalition terroriste dirigée par Iyad Ag Ghali, le « Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans », qui regroupe notamment Aqmi.
Assez maigre, les traits tirés, Stephen McGown paraissait alors assez affaibli et abattu psychologiquement. « Cela fait une dizaine de vidéos que je fais, je ne sais plus trop quoi dire », confiait-il, avant d'ajouter, après un moment d'hésitation : « Si quelqu'un, qui que ce soit, peut m'aider... »